L’événement est organisé par Bruno Bazin (C’Chartres Archéologie, UMR 8546, CNRS–ENS, Paris), Frédéric Guibal (IMBE, UMR 7263), Stéphane Lamouille (IRAA UAR 3155, CNRS, AMU, UPPA, MOM Lyon 2), Sylvie Rougier-Blanc (CRHEC, UPEC) et Magali TORITI (Université de Rennes, CReAAH, UMR 6566).
Les multiples bio-indicateurs analysés en paléoécologie sont particulièrement précieux pour reconstituer l’histoire des paléoenvironnements. Parmi eux, l’analyse pollinique et la pédoanthracologie retracent les évolutions et les variations du couvert végétal et aident à la restitution des paysages anciens. En archéologie, les conditions de conservation des macrorestes végétaux et la nature même des contextes d’étude obligent les approches méthodologiques à s’adapter. Ainsi, les vestiges ligneux mis au jour sur un site archéologique sont les témoins de l’activité humaine passée. À la lumière de l’anthracologie, de la xylologie et de la dendrochronologie, l’identité taxonomique, la datation et l’observation des caractéristiques des bois impliqués traduisent, en plus de la technologie employée, notamment la sélection humaine qui, elle-même, reflète la disponibilité ou l’indisponibilité locale du taxon considéré.
Les récentes découvertes de près de 2 000 bois antiques dans le sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val (Chartres, Eure-et-Loir) soulèvent de nouvelles questions sur l’utilisation des essences dans l’architecture. Le sapin, encore lui, y est majoritaire dans la composition d’un plafond à caissons alors qu’il ne s’agit pas d’une essence originaire de la région de Chartres. L’essence a-t-elle été délibérément choisie pour ses propriétés mécaniques, sa facilité de façonnage, sa légèreté, sa résistance ? La question de sa provenance et de la logistique de transport qui en découle, est aussi prégnante : quels étaient les circuits d’approvisionnement du bois d’œuvre ? Comment peut-on aujourd’hui retracer ces circuits et mieux comprendre l’économie du bois ? Y avait-il un circuit propre au bois d’œuvre ? Existait-il des essences particulièrement prisées et si oui, pourquoi ? Le choix dépend-il du type de construction ? L’aire de distribution passée de l’essence est-t-elle impliquée ?
Cette nouvelle rencontre « Bois et architecture » souhaite proposer une réflexion critique sur le choix des essences dans l’architecture durant la Protohistoire et l’Antiquité à partir d’exemples attestés archéologiquement. Le recours ponctuel aux comparaisons historiques (Moyen-Âge notamment) est aussi prévu. De la même manière, la problématique initiale concerne le monde gallo-romain, le monde italique et le monde égéen – Grèce et Crète plus particulièrement – mais la réflexion s’ouvrira à d’autres régions pour la période antique (Europe occidentale, Balkans, Proche-Orient, Égypte, Maghreb, Japon). Les connaissances actuelles et passées de la biogéographie et les aspects méthodologiques seront aussi abordés, de la gestion des bois lors des fouilles jusqu’à leur conservation, en passant par la phase d’analyse qui implique le recours à des spécialistes des sciences de l’environnement. Comment préserver au mieux ces vestiges souvent exceptionnels et difficiles à analyser ? Comment les valoriser auprès du public en tant qu’objets patrimoniaux ?
Contact :
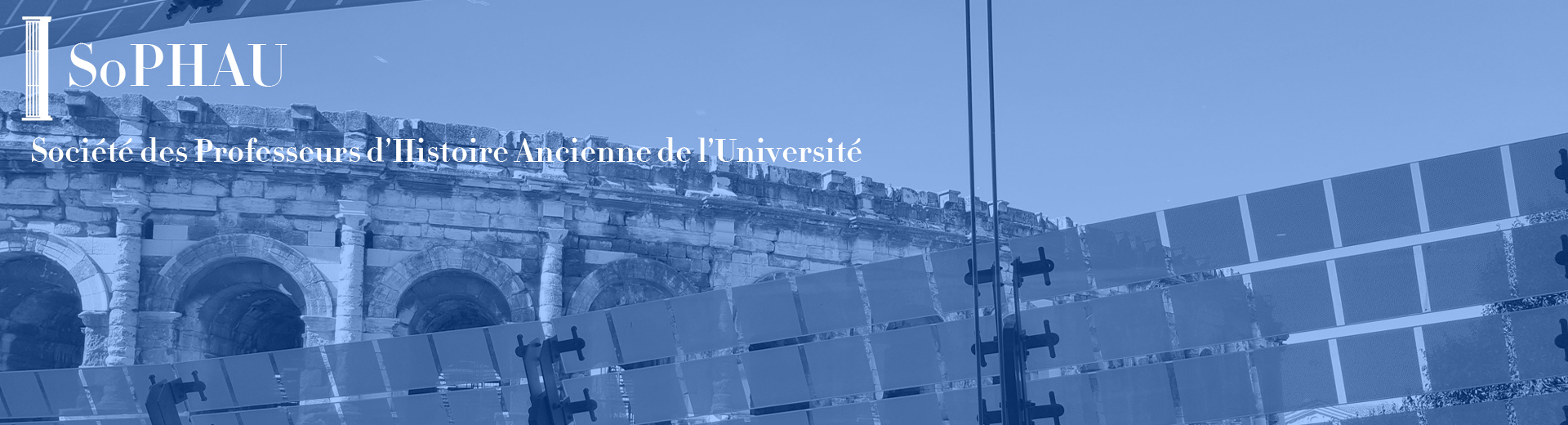



 Flux Alerte
Flux Alerte